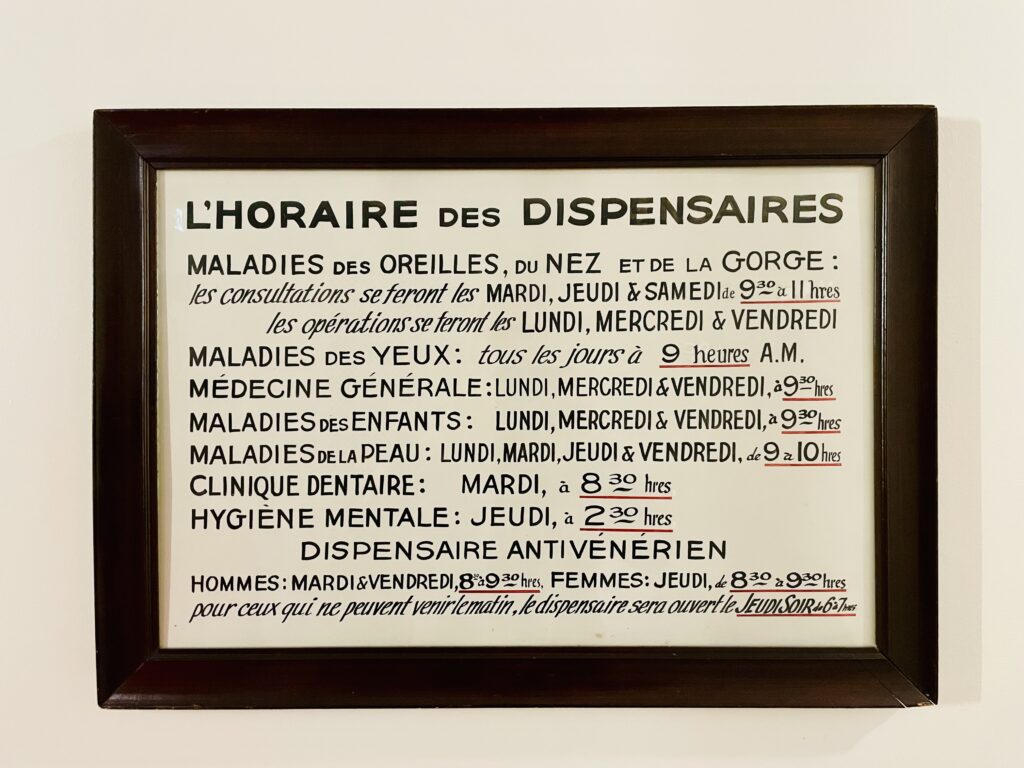Un à un, des êtres venaient s’asseoir près de moi ; nous parlions à voix basse ; puis ils se levaient pour se dévêtir et s’étendre sur le divan : alors je palpais leur nudité, j’écoutais leur souffle et les pulsations de leur cœur. Pendant qu’ils s’habillaient, je retournais à mon fauteuil pour écrire quelques lignes. Ils me donnaient un peu d’argent, me serraient la main et s’en allaient. Tant bien que mal, pour chacun d’eux j’avais déchiffré une énigme et inscrit ma réponse sur la feuille qu’ils pliaient en quatre et emportaient sans la regarder.
La pièce voisine bondée – toux d’automne, ventres douloureux, foies vindicatifs – remuait vaguement, murmurait, déplaçait des chaises ; je l’entendais vivre à travers une mince cloison derrière laquelle attendaient une dizaine de personnes lisant ces revues de voyage et de gastronomie que les fabricants de remèdes distribuent gratuitement aux médecins. La salle d’attente d’un docteur bruit comme une cage d’oiseaux ; elle emprisonne des rêves, des angoisses et parfois de singulières odeurs.
Assis à mon bureau, sagement, comme un écolier à son pupitre, j’étais au centre de la pensée de tous ceux qui attendaient, me regardaient, m’écoutaient et s’en allaient. Depuis des années, cela se renouvelait tous les jours ; cela continuerait encore jusqu’au désastre personnel autour duquel peureusement mon imagination tournait parfois. Mais ce jour-là – le jour où commença cette histoire – une pensée, un souvenir insolites troublaient la quiétude monotone de l’univers limité et raisonnable où j’avais choisi de vivre. […]
Je suis médecin, et les médecins sont des gens pressés qui comptent leur temps et leur argent. Ils glissent dans un monde auquel ils ne participent qu’à demi ; un mur les sépare de la vie qu’ils surveillent. Pour eux, tous les êtres s’agitent en un coma permanent et, parce qu’ils la connaissent, ils se tiennent à l’écart de l’universelle agonie. Leur expérience est le résidu de souffrances aiguës ou monotones. Dès l’aube, ils lèvent le drap du dernier mort de la nuit, puis errent parmi des formes qui se plaignent, qui pleurent, qui simulent. Après des années, ces témoins permanents du passage et de la fluidité de la vie devraient aboutir au plus rigoureux désespoir. Mais le vieil inconscient humain les avilit ou les protège de trop de lucidité et ces spectateurs de toutes les angoisses ne sont pour la plupart que de petits épargnants. […]
J’étais un petit docteur attaché à une banlieue triste. Je savais un peu de médecine : la digitale ranime les cœurs, la morphine endort les douleurs vives, la pénicilline modère les fièvres. Quand je devinais un cancer, un peu attristé je disais : « Vous entrerez à l’hôpital. » Contre la toux et les rhumes je formulais des potions délicieuses. Mais au-delà d’une vie calme subsistait un regret qui, certains jours, ressemblait à un remords. Jadis il y avait eu pour moi un départ émouvant de France, et une période de pérégrinations, puis un retour à partir duquel mon existence avait changé. Les mers et les îles n’avaient pas voulu de moi. Fixé dans ma ville, j’étais devenu le médecin d’un quartier malheureux ; j’avais accepté ce destin et un horizon de hautes maisons misérables. Des infiniment pauvres, des intouchables puis des ouvriers, des employés chétifs avaient frappé à ma porte : je les avais soignés comme, là-bas, j’eusse soigné les lépreux. Tout le jour, ils venaient s’étendre sur mon divan brûlé par leur fièvre, verni par la sueur de leurs angoisses. Le soir, un cartable sous le bras comme les policiers, j’escaladais les exténuants escaliers de la misère : ces spirales semblent mener au ciel et finissent au corridor noir de l’enfer prolétarien. Je pensais que ces gens m’aimaient et comme quelque chose persistait en moi de cette bonté naïve de l’enfance, cela m’avait longtemps suffi. Un jour, des boutiquiers, des bouchers, des coiffeurs, des marchands de primeurs m’honorèrent de leur confiance. Un filet d’argent coula de la maladie et de la mort. Au temps de cette histoire, ma réputation s’étendait hors du faubourg ; des individus riches sonnaient craintivement à ma porte et entraient, gênés comme dans un mauvais lieu. Parmi ces travaux et ces délices, l’amour de la mer, le souvenir de la Polynésie ne pouvaient survivre. Après bien des années, le lent travail de la vie, cet effritement invisible et ininterrompu, avait fini par m’en détacher. J’avais ressenti l’oubli, ce mal, en un temps où je ne pouvais rien pour en arrêter les ravages. Alors, j’avais renié la Polynésie, ces îles éparpillées, grains égaux sur la carte d’un atlas, où mon enfance avait placé tout l’espoir de la vie et que, plus tard, j’avais vues sortir de la mer. Un jour, je reconnus qu’il était possible de vivre loin d’elles ; un sentiment avait fondu sans bruit. Mais parfois il me fut dur d’évoquer ce que j’avais tant aimé et dont il ne restait rien, hormis un vague regret. Et cela dura jusqu’au jour où une lettre, arrivée par miracle, m’apprit la survivance de Palabaud, l’homme des mers du Sud.
— Jean Reverzy, le Passage