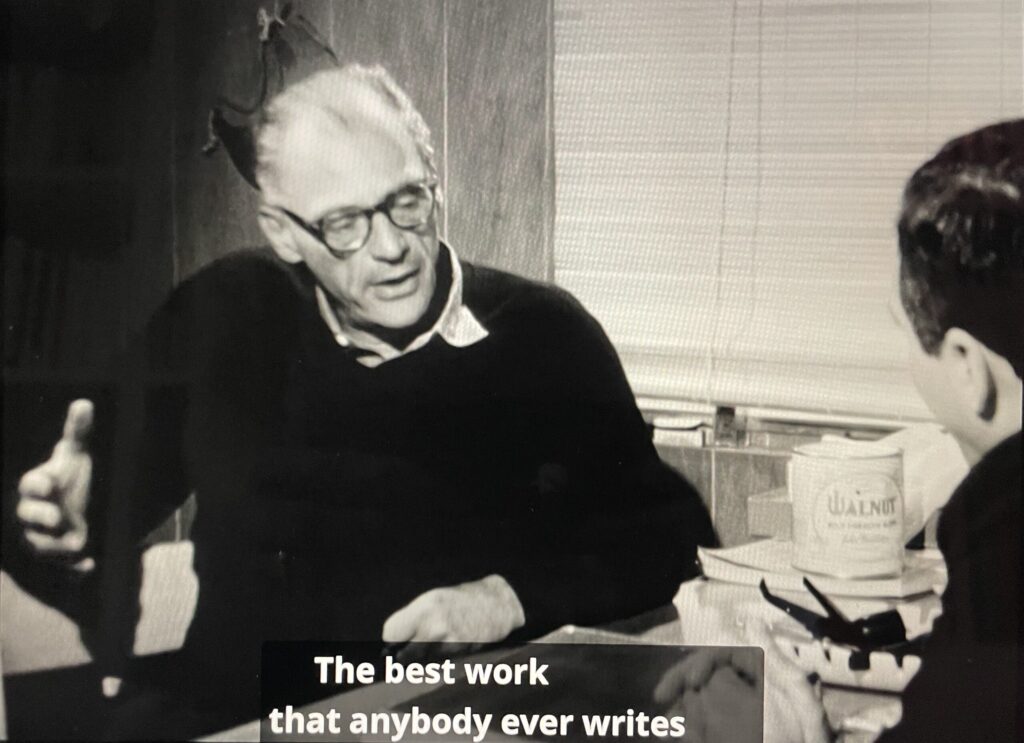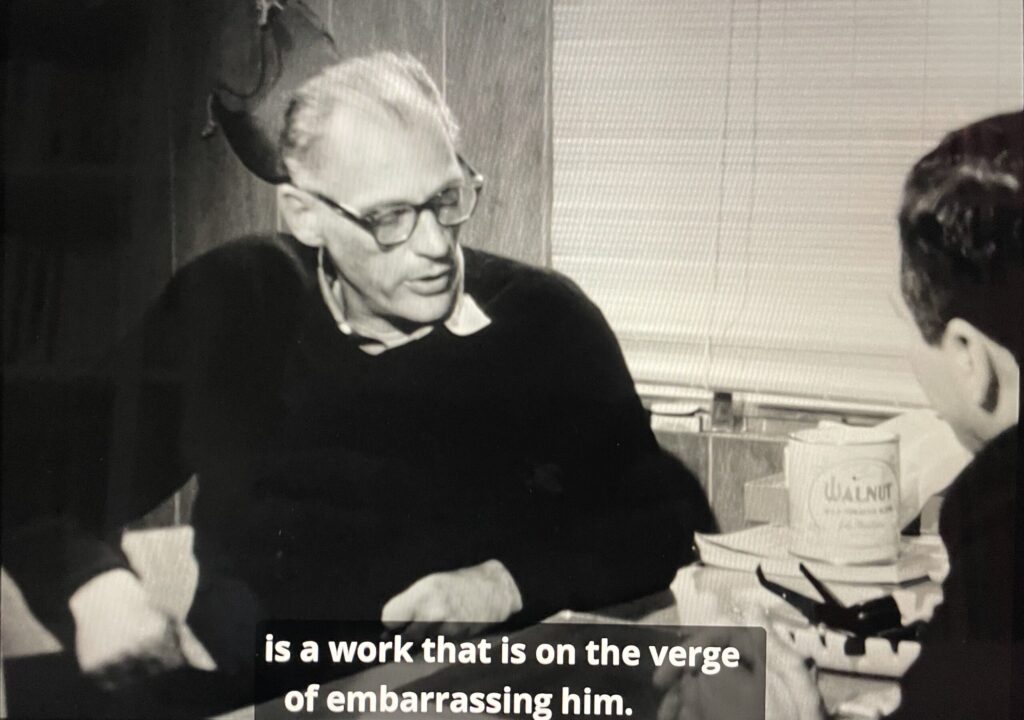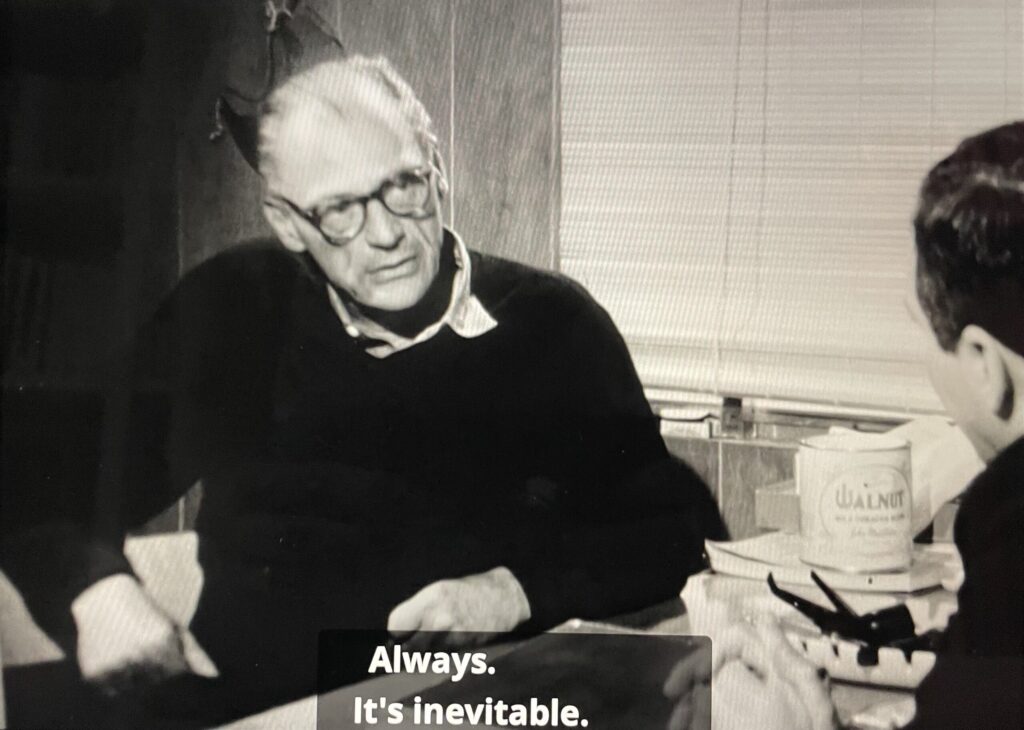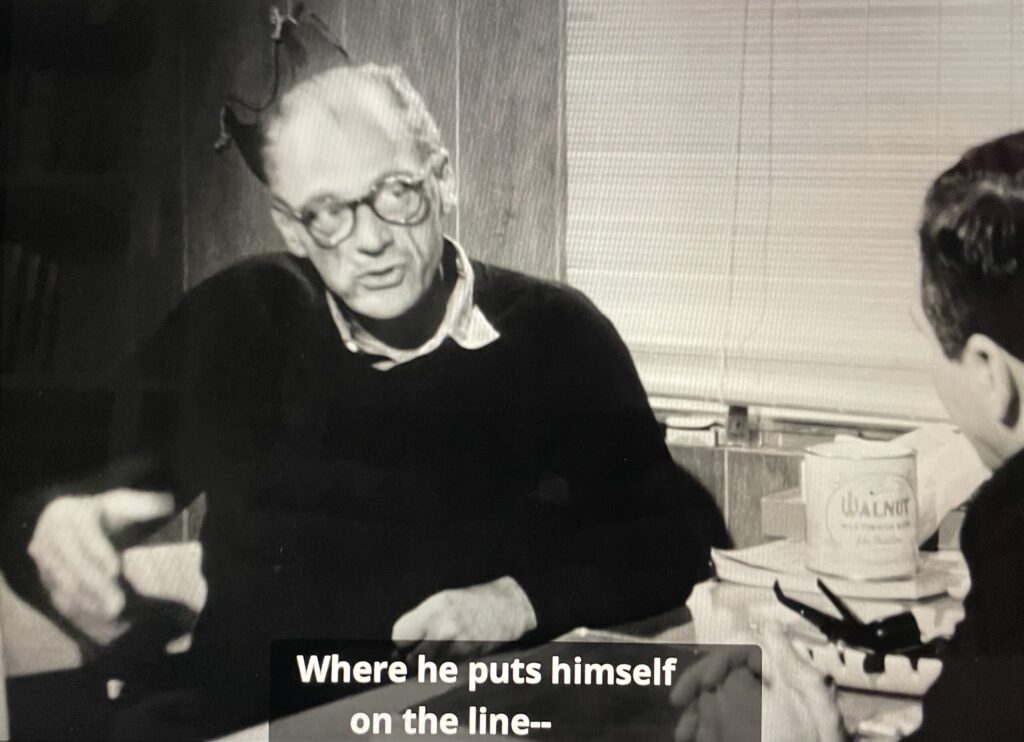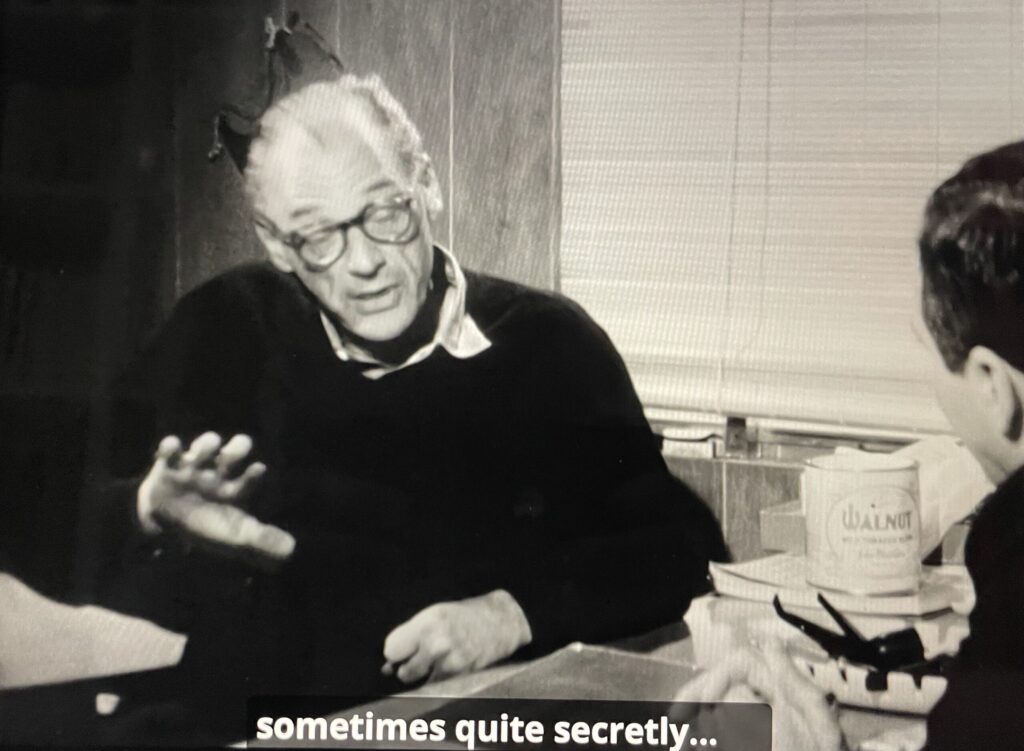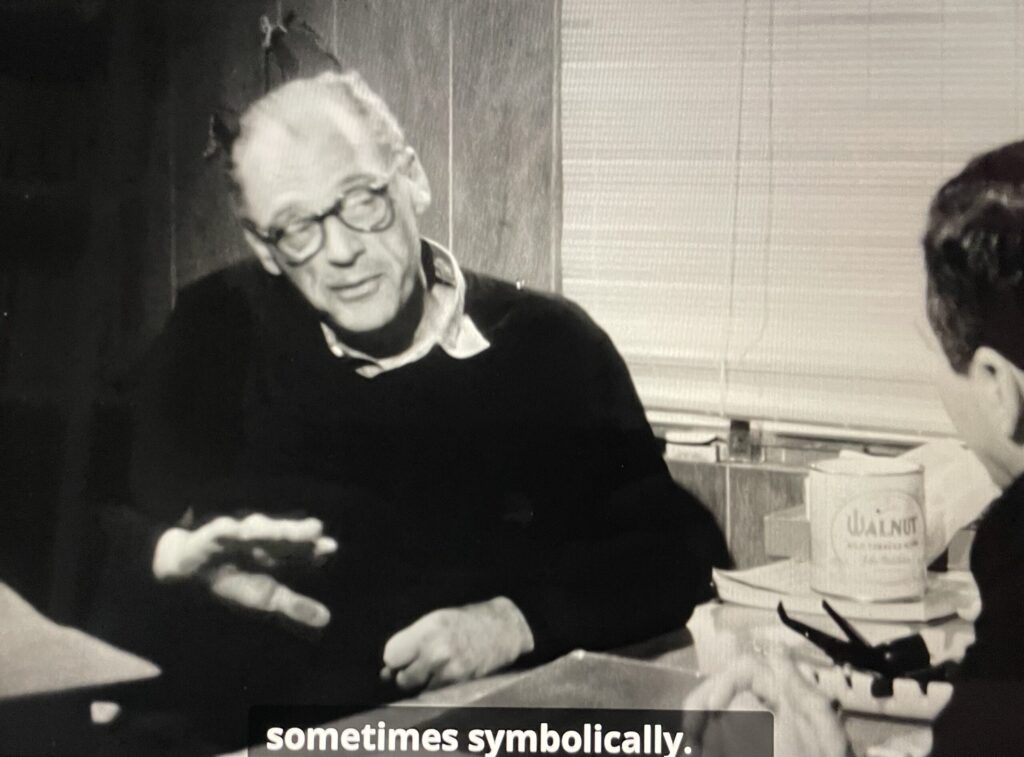M. Caravan avait toujours mené l’existence normale des bureaucrates. Depuis trente ans, il venait invariablement à son bureau, chaque matin, par la même route, rencontrant à la même heure, aux mêmes endroits, les mêmes figures d’hommes allant à leurs affaires ; et il s’en retournait, chaque soir, par le même chemin où il retrouvait encore les mêmes visages qu’il avait vu vieillir.
Tous les jours, après voir acheté sa feuille d’un sou à l’encoignure du faubourg Saint-Honoré, il allait chercher ses deux petits pains, puis il entrait au ministère à la façon d’un coupable qui se constitue prisonnier ; et il gagnait son bureau vivement, le cœur plein d’inquiétude, dans l’attente éternelle d’une réprimande pour quelque négligence qu’il aurait pu commettre.
Rien n’était jamais venu modifier l’ordre monotone de son existence ; car aucun événement ne le touchait en dehors des affaires du bureau, des avancements et des gratifications. Soit qu’il fût au ministère, soit qu’il fût dans sa famille (car il avait épousé, sans dot, la fille d’un collègue), il ne parlait jamais que du service. Jamais son esprit atrophié par la besogne abêtissante et quotidienne n’avait plus d’autres pensées, d’autres espoirs, d’autres rêves, que ceux relatifs à son ministère. Mais une amertume gâtait toujours ses satisfactions d’employé : l’accès des commissaires de marine, des ferblantiers comme on disait à cause de leurs galons d’argent, aux emplois de sous-chefs et de chefs ; et chaque soir, en dinant, il argumentait fortement devant sa femme, qui partageait ses haines, pour prouver qu’il est inique à tous égards de donner des places à Paris aux gens destinés à la navigation.
Il était vieux, maintenant, n’ayant point senti passer sa vie, car le collège, sans transition, avait été continué par le bureau, et les pions, devant qui il tremblait autrefois, étaient aujourd’hui remplacés par les chefs, qu’il redoutait effroyablement. Le seul de ces despotes en chambre le faisait frémir des pieds à la tête ; et de cette continuelle épouvante il gardait une manière gauche de se présenter, une attitude humble et une sorte de bégaiement nerveux.
— Guy de Maupassant, En famille